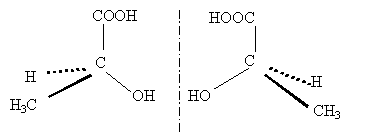les dix questions précédentes 1 à 10
|
|
|
|
On constitue un pendule électrique en suspendant une boule de polystyrène, métalisée en surface, à un fil nylon. La boule est chargée par contact puis on l'approche d'une boule chargée positivement. Le pendule s'écarte d'un angle a.
- Quel est le signe de la charge portée par la boule du pendule
- Représenter les forces agissant sur la boule du pendule?
- Exprimer en fonction de m, g et a, puis calculer la valeur de la force électrique ?
m = 0,5 g ; a= 30° ; g = 10 m/s² ; sin 30 = 0,5 ; cos 30 = 0,866 ; tan 30 = 0,577
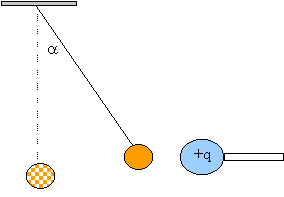
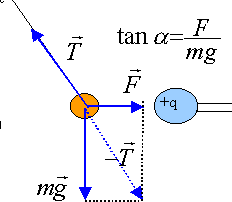
m = 5 10-4 kg
F= 5 10-4 *10 / tan 30 = 8,6 10-3 N
- Enoncer la loi d'attraction universelle de Newton. Donnez l'expression du champ de gravitation crée par une masse M ponctuelle en un point A situé à la distance d de cette masse.
- La terre possède une répartition de masse à symétrie sphérique. Donner l'expression de la force qui s'exerce sur une masse m ponctuelle située au niveau du sol.
- Donnez l'expression du champ de gravitation au niveau du sol (altitude h=0)
- Calculer la masse de la Terre g0 = 9,81 m/s² ; G=6,67 10-11 S.I; RT = 6400 km
- exprimer le champ de gravitation à l'altitude h en fonction de g0, RT et h.
Deux masses M et m, ponctuelles, située à la distance d l'une de l'autre , exercent entre elles des forces attractives, proportionnelles aux masses et inversement proportionnelles au carré de la distance qui les sépare.
valeur de F = G M m / d²
masses en kg et d en mètre; G constante de gravitation.
cas de la terre ( en surface) : la distance d est le rayon terrestre et M est la masse de la terre.
champ de gravitation au sol : g0 = GM /R²
masse de la terre : M = g0 R2 / G
avec R= 6,4 106 m
M = 9,81 * 6,4 ² 1012 / 6,67 10-11 = 6 1024 kg
champ de gravitation à l'altitude h : g = G M / (R+h)²
avec GM= g0 R² d'où g = g0 R² / (R+h)².
Un jongleur lance vers le haut, verticalement avec une vitesse v0 = 10 m/s une balle de masse 100g. Les frottements seront négligés. L'origine des temps est l'instant ou le jongleur lance la balle et l'origine des espaces est le sol .L'altitude initiale la balle est d=1 m. (axe vertical vers le haut). g = 10 m/s².
- Quelle est l'équation horaire du mouvement de la balle?
- A quelle date l'altitude maxi est telle atteinte ?
- Quelle est l'altitude maxi ?
- A quelle date arrive t-elle au sol ? racine carrée (120) voisine de 11.
- Quelle est la vitesse au sol ?
vecteur vitesse initiale v0 = 10
altitude de départ 1 ( altitude zéro au sol)
vitesse à une date t : primitive de l'accélération v = - g t + v0 = -10 t + 10
altitude à une date t : h =
-½ gt² +v0t + 1= -5 t² +10 t +1
altitude maxi
: la vitesse s'annule : -10t +
10 = 0 d'où t = 1 s
h maxi = -5 +10 +1 = 6 m.
arrivée au sol : h=0
0 = -5 t² +10 t +1
D= 100+20 = 120
t = (-10 -11 ) / (-10) = 2,1 s
vitesse = -10 *2,1 +10 = 11 m/s.
Un satellite de télécommunication géostationnaire, a une trajectoire circulaire dans le plan de léquateur. Il reste à l'altitude constante de 36 000 km et paraît fixe pour un observateur terrestre. Le référentiel d'étude est géocentrique.
- Donner l'expression de sa vitesse angulaire, puis de sa vitesse linèaire.
- Déterminer la direction, sens et borme de son accélération.
- Donnez l'expression du poids du satellite à l'altitude h
rayon de la terre R ; champ de gravitation au sol g0 ; période de la terre T.
w = 2p f = 2 p / T
la vitesse angulaire et la vitesse linéaire (m/s) sont proportionnelles :
v = w (R+h)
Le mouvement du satellite est circulaire uniforme: l'accélération est centripète, dirigée vers le centre de la terre
aN= v² / (R+h)
champ de gravitation à l'altitude h : g = g0 R² / (R+h)²
poids du satellite à l'altitude h : mg = mg0 R² / (R+h)²
- Calculer l'accélération
- Calculer le temps mis pour atteindre une vitesse de 90 km /h
- Quelle est la vitesse atteinte lorsqu'il a parcouru 400 m
- Mêmes questions si le dragster initialement immobile atteint la vitesse de 100 m/s en 2s.
mùouvement uniformément accéléré avec vitesse initiale nulle
d = ½ a t² d'où a = 2*400 / 16 = 50 m/s²
90 km/ h = 90 /3,6 = 25 m/s
vitesse = at d'où t = 25 /50 = 0,5 s.
vitesse lorsque d = 400 m :
400 = ½ *50 *t² d'où t² = 16 et t= 4s
vitesse = 50 *4 = 200 m/s
accélération = variation de la vitesse (m/s) / durée de la variation (s)
a = 100 / 2 = 50 m/s²
même accélération, mêmes conditions initiales, donc mêmes résultats.
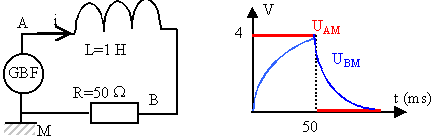
- Le point A est relié à la voie (1) de l'oscilloscope, M à la masse et B à la voie (2) de l'oscilloscope. Quelles tensions visualise t-on ?
- Exprimer UAM en fonction de R, L i et t.
- Quelle est la fréquence de la tension UAM.
- Quelle est la constante de temps du circuit ?
- Comment évolue la tension UBM si
- on augmente R
- on augmente L
- on augmente la fréquence f
voie (2) on visualise la tension aux bornes de la résistance, UBM, soit l'image de l'intensité au facteur R près.
UAM = UAB + UBM = L di / dt + Ri = di /dt +50 i
fréquence (Hz) = inverse de la période (s)
période = 100 ms = 0,1 s d'où f = 10 Hz.
la constante de temps est une mesure du retard à l'établissement du courant dans un circuit inductif
t = L/R = 1/50 = 0,02 s = 20 ms
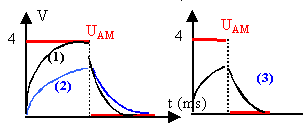
(1) R augmente, la constante de temps diminue
(2) L augmente, la constante de temps augmente
(3) la fréquence f augmente, la période diminue
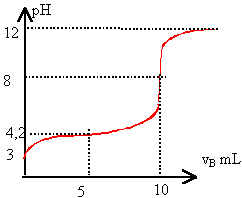
On prépare une solution (solution S0) d'acide benzoïque en dissolvant une masse m de solide dans 200 mL d'eau. On effectue un dosage à partir de 10 mL de cette solution. à l'aide d'une solution de soude de concentration 0,1 mol/ L.
- Quelles sont les couples en présence dans la solution S0.
- Ecrire l'équation bilan de la réaction de l'acide benzoïque avec la soude.
- Justifier le pH à l'équivalence. Quel est le pKa du couple acide benzoïque/ ion benzoate.
- Calculer la concentration molaire de la solution S0.
- Quel indicateur faut_il choisir
hélianthine ( 3,1- 4,4 ); bleu de bromothymol ( 6,2- 7,6) ; phénolphtaléine ( 8-10)
H2O / HO- pKa = 14
C6H5COOH / C6H5 COO- pKa =4,2 ( lecture graphe)
H3O+ / H2O pKa = 0
C6H5COOH + HO- donne C6H5 COO- + H2O
On a mis en présence l'acide le plus fort avec la base la plus forte. Les pKa étant différents de 9,8 , Kr est grand (109,8) la réaction est totale.
A l'équivalence , les quantités de réactifs sont en proportions stoéchiométriques:
l'acide benzoique et l'ion hydroxyde sont consommés :
il reste l'ion benzoate, une base faible, alors le pH sera plus grand que 7
le pH à la demi équivalence d'un dosage acide faible base forte est égal au pKa du couple acide benzoïque / ion benzoate.
CaVa = Cb Vb à l'équivalence
Ca = 0,1*10 / 10 = 0,1 mol/L pour la solution S0 .
la zone de virage de l'indicateur coloré doit contenir le pH à l'équivalence : d'où phénolphtaléine.
Un bécher contient 200 mL d'acide chlorhydrique de concentration inconnue. On ajoute dans ce bécher de l'hydroxyde de sodium (Cb = 0,5 mol /L) à l'aide d'une burette et on mesure le pH.
tracer la courbe pH= f'( Vb)Vb (mL) 0 2 3 4 4,5 4,9 5 5,1 5,5 6 8 10 pH 1,9 2,1 2,3 2,6 2,9 3,6 5,1 10,3 11 11,3 11,6 11,8 - Déterminer le point d'équivalence et en déduire la concentration de la solution acide. Que vaut le pH à l'équivalence
- Calculer les concentrations des ions hydronium et hydroxyde quand on a versé 3 mL de soude.
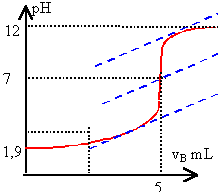
H3O+ + HO- --> 2 H2O
à l'équivalence les quantités de matière d'acide et de base sont stoéchiométriques
CaVa = CbVb
Ca = 5*0,5 / 200 = 0,0125 mol/ L
si Vb = 3 mL le pH vaut 2,3 et [H3O+]= 10 -2,3 mol/L = 5 10-3 mol / L
produit ionique de l'eau [H3O+] [HO-] =10-14 à 25°C
[HO-] = 10-14 / 5 10-3= 2 10-12 mol /L
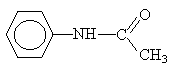
- Quelle est la fonction chimique principale de l'antifébrine.
- La synthése de l'antifébrine peut être réalisée à partir de l'acide éthanoïque et de l'aniline C6H5-NH2. Ecrire l'équation bilan.
- Quel (s) autre(s) réactifs peut on utiliser à la place de l'acide éthanoïque et quel en est l'intérêt.
- Ecrire l'équation bilan dans le cas de l'anhydridre d'acide
- Mettre en évidence les sites électrophile et nucléophile et représenter par une flèche le transfert d'électrons.
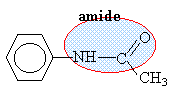
C6H5-NH2 + CH3-COOH donne C6H5-NH -CO-CH3 +H2O
On utilise l'anhydride éthanoïque ( CH3-CO-O-CO-CH3) ou le chlorure d'éthanoyle ( CH3-COCl) ( plus réactifs que l'acide) à la place de l'acide éthanoïque car dans ce cas la réaction est totale et rapide.
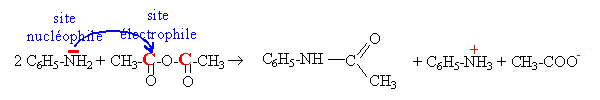
réactif électophile : possède un site appauvri en électrons (atome de carbone du groupe carbonyl "C=O")
réactif nucléophile : possède un site riche en électrons ( atome d'azote)
L'acide lactique contenu dans le lait est un acide faible noté AH (masse molaire 90 g/mol). On dose 20 mL de lait par une solution d'hydroxyde de sodium à0,02 mol/L. Le virage de l'indicateur coloré est obtenu pour un volume de soude égal à : 17,8 mL
- Donner la définition d'un acide puis celle d'un acide faible.
- Ecrire l'équation chimique de la réaction qui a eu lieu
- Un lait frais ne doit pas contenir plus de 2,2 g d'acide lactique par litre; ce lait est t-il frais?
- L'acide lactique a pour formule brute C3H6O3. Donnez sa formule semi développée sachant que la molécule contient une fonction alcool en plus de la fonction acide. L'un des carbones est asymétrique, représenter les 2 énantiomères.
acide faible : la réaction avec l'eau est partielle; un acide faible est peu ionisé dans l'eau
AH+ HO- donne A- + H2O
A l'équivalence CaVa = CbVb d'où Ca = 17,8*0,02 / 20 = 0,0178 mol /L
multiplier par la masse molaire : 0,0178*90 = 1,3 g /L
valeur inférieure à 2,2 g / L, donc le lait est frais.